Comment sortir de l’impasse sociale de la propriété privée exclusive ? Guillaume Dezaunay propose un essai fondé sur les « paraboles des intendants » des évangiles : nos biens et nos pouvoirs ne nous appartiennent pas vraiment, seule compte leur utilité sociale. Un livre inspirant quelles que soient les convictions du lecteur.
Le livre se présente comme une réflexion à propos des « paraboles des intendants » qui fourmillent dans les évangiles sur l’argent, la gestion, l’avoir et le pouvoir. Chacun des 19 courts chapitres met en exergue une parabole parmi les plus connues ou d’autres plus inattendues. Derrière le titre évidemment provocateur du livre – la notion de bien commun est-elle communiste ? – Guillaume Dezaunay propose une lecture de la radicalité du message du Christ que l’on pourra qualifier aussi bien spirituelle, philosophique ou politique. Une lecture accessible à tous, attrayante parce qu’elle n’est pas si fréquente et qu’elle a le mérite de s’attaquer aux grandes questions politico-économiques contemporaines. La logique d’intendant ou de gestionnaire de ce qui nous est confié est l’inverse de la logique de propriétaire, nos pouvoirs sur les biens et les personnes ne sont que de services et il ne s’agit pas de métaphores.

Pensée sociale de l’avoir et du pouvoir
Dezaunay est un jeune philosophe marqué par la lecture d’Emmanuel Levinas, d’Hannah Arendt et surtout, en l’occurrence, de « Résurrection » de Tolstoï. Dans ce roman, un aristocrate prend conscience de ses privilèges et les abandonne progressivement. C’est un peu le chemin que propose d’emprunter Dezaunay. Les points centraux des deux premières parties sont peut-être la critique de l’appropriation privative qui apparaît en définitive stérile, génératrice de violence à cause du mimétisme humain et incapable de répondre à notre vif désir de sécurité (p 40-43) ; la critique de l’héritage, absurde s’il est égoïstement dilapidé ou s’il ne sert pas la justice, illégitime s’il ne produit pas des fruits de bonté (p 45-47) ; la critique de l’argent qui asservit s’il ne sert pas l’harmonie sociale et la fraternité (p 29-34); la critique de la marchandisation à outrance (p 59-66).
L’auteur évoque ainsi des éléments de pensée sociale sur les thèmes de l’avoir et du pouvoir, et il esquisse « une théologie de l’expropriation » qui vient contrer la « pseudo-théologie de la prospérité » faisant croire que les profits sont mérités et dons de Dieu (p 99). « Choisir la vie plutôt que la mort » (Deutéronome 30, 19) signifie pour lui choisir la justice et la bonté qui résume « l’esprit du Règne », non pas la compétition et l’esclavage. Il faut « quitter l’anthropocentrisme déviant ». Mais pourquoi est-on si peu attentif à ce désir de justice, et pourquoi faisons nous si peu pour lutter contre l’injustice sociale ? L’auteur esquisse une théorie sur le libéralisme qui historiquement serait parvenu à nous convaincre indument que le profit comme but en soi est incontournable, que les pauvres n’ont droit à rien et qu’au total seul une rationalisation de l’égoïsme serait efficace (p 19). On aurait aimé qu’il développe ce point, peut-être sera-ce pour un ouvrage ultérieur.
Pistes pratiques
La troisième partie (“Que faire ?”) propose des pistes plus pratiques pour soi et pour notre monde, en réaction devant les dérives économiques, sociales et environnementales. « Il est temps de retrouver la dimension matérialiste de la spiritualité chrétienne », c’est-à-dire satisfaire vraiment les besoins des nécessiteux (p 122). « L’éthique est une optique » disait Levinas, n’est-ce pas ce qu’indique aussi Mt 25, 40 « ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » ? Il s’agit d’apprendre « à être de bons intendants », « la voie d’un pouvoir qui devient service et qui se répand en autonomisation des plus fragiles » (p 127). Dezaunay propose aussi sa vision de l’écologie intégrale sortant la théologie chrétienne traditionnelle de sa torpeur immobiliste face à l’appropriation du vivant, la surconsommation, la globalisation sans limites, l’identitarisme, la méritocratie, etc.
Une lecture possible de ce livre est qu’il s’agit de « réchauffer la magnifique doctrine sociale de l’Église malgré ses conceptions culturelles limitées » (p 13). L’auteur propose en effet une illustration personnelle des grands principes de cette doctrine et des écrits du pape François : la « destination universelle des biens », le « bien commun », la « justice », « l’amitié sociale », « la fonction sociale de la propriété », etc.
Radicalité des évangiles
Il s’adresse principalement à la « bourgeoisie catholique » dont il fait partie, et dans le prologue, installé à une terrasse d’aéroport, se disant riche, décroissant et chrétien, il décide de prendre l’avion pour la dernière fois, qu’il est temps « de comprendre que le christianisme sans quête de justice sociale et sans recherche du bon régime économique n’est pas le christianisme » et que lire des textes révolutionnaires réclamant justice pour tous sans jamais aller dans « les trous des pauvres » paraît hypocrite (p 10). Pour la « bourgeoisie catholique », les paroles et les gestes du christ rapportés par les écritures font en principe autorité. C’est pourquoi Dezaunay cherche à la convaincre en renversant l’interprétation classique qu’en donne le christianisme identitaire. Comment en effet ne pas être stupéfait par l’écart entre les croyances conservatrices qui se satisfont fort bien de privilèges indécents, et la lecture des évangiles comme la critique la plus sévère qui soit de nos errements socio-économiques contemporains ? L’Évangile ne serait-il pas l’instance critique la plus radicale pour toute pensée concernant le plus humain de l’humain, comme l’avait suggéré Maurice Bellet ? Ou bien le christianisme n’existerait-il pas encore vraiment (Dominique Collin) ? En dépoussiérant le sens du texte, en choisissant des mots simples sans se laisser aller à des simplifications abusives ou à des dénis de réalité, Dezaunay fait œuvre extrêmement utile. Il témoigne notamment d’une perspective très positive pour l’Église en lui suggérant qu’il n’y a pas de religion valable qui ne soit toujours en train de réinterpréter sa vérité.
Lire ce livre revient certainement à redécouvrir la nouveauté révolutionnaire des évangiles et de la pensée sociale catholique. Mais c’est d’abord un essai de bon sens et de saine réaction contre les méfaits du capitalisme mondialisé. Le souffle de ce livre n’est pas seulement salutaire pour les chrétiens, il intéressera aussi tous les passionnés de justice et de démocratie. L’ouvrage a l’apparence d’un témoignage personnel mais c’est tout le contraire : il s’agit de la genèse d’une parole collective qui fonde l’action, et l’amorce d’une prise de conscience qui vaut pour une Église neuve comme certainement pour d’autres institutions aussi. Ce livre, agréable à lire et facile d’accès, est recommandé à toute personne que la soif d’un avenir commun intéresse.
Guillaume Dezaunay, Le Christ rouge, Salvator, 2023, 170 pages, 17,90 €

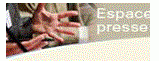

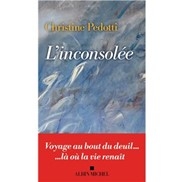

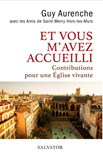
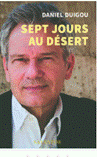


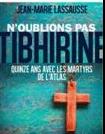



















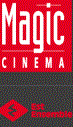





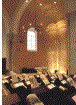
















/image%2F0933224%2F20240706%2Fob_2e4420_musulmans-et-francais.png)




